Historique des images
Contenu
Le 4 février 1428, une école prend feu à Forlì, en Italie.
De cet incendie survécut une image, l’une des plus anciennes estampes que l’on conserve encore, « La Madone de feu ». À l’origine simple gravure sur bois qui devait orner le mur d’une classe et recueillir les prières des enfants, elle est devenue une icône mystique, protégée dans une chapelle dédiée de la cathédrale de Forlì. Son culte persiste à ce jour, dans la ville et au-delà, des bougies sont allumées en son honneur (ce qui ne semble pas être la meilleure idée), et les pèlerins déposent leur propre photo au sein de l’église, dans l’espoir d’imprégner sur leur image la puissance de la madone.
Surplombant l’entrée de la salle de lecture, Μνημοσύνη veille.
Déesse de la mémoire dans la mythologie grecque, Mnémosyne donna naissance aux Neuf Muses. Et dans nos âmes elle fit naître… un bloc de cire. C’est ainsi que Socrate parle de notre capacité à nous remémorer le passé : « toutes les fois que nous voulons nous souvenir de quelque chose que nous avons vu, ou entendu, ou conçu nous-mêmes, nous tenons ce bloc sous nos sensations et nos conceptions et les y imprimons, comme nous gravons le sceau d’un anneau, et que ce qui a été imprimé ainsi, nous nous le rappelons et le savons, tant que l’image reste sur la cire » (Théétète, 191).
Les filles de Mnémosyne président aux arts, ceux du théâtre, de la musique, du récit : leur noblesse contraste sans doute avec ceux, plus bas, matériels, de l’image, la représentation visuelle du monde. L’empreinte de cire peut tout imprimer, transmettre, évoquer, mais il manque à l’image d’être reconnue à l’égal d’une muse, comme porteuse de discours. L’image, en réalité, c’est alors celle créée par les mots, l’ekphrasis qui fait germer dans notre esprit un dessin clair et précis. Notre image ne parle pas. Pas d’elle-même. D’ailleurs, les plus fameuses légendes grecques relatives aux prouesses des artistes célèbrent leur capacité à imiter le réel, à tromper : le célèbre peintre Zeuxis provoqua en duel son confrère Parrhasios. Zeuxis présenta à l’assemblée une représentation de raisins si véritable que les oiseaux s’y seraient trompés. Se tournant vers l’œuvre de Parrhasios, il demande à ce qu’on la dévoile… Cependant que le voile était en fait peint ! Platon lui-même ne porte que peu de crédit au faiseur d’image, dont la mimesis de la nature ne produit rien que du "dénaturé". L’image ne serait pas tant un langage, création d’un discours, que l’imitation, le mur de nos sensations. Une image peut-elle (nous) parler ? A-t-elle même quelque chose à dire ?
On pourrait évoquer à l’inverse le mythe de Callirrhoé. La jeune femme voyant son amant partir à la guerre choisit de s’armer d’un charbon. Éclairé d’une bougie, le profil de l’être aimé se découpait contre le mur : elle suivit la ligne pour conserver son ombre, peut-être même une partie de lui. Il n’est plus question d’un trompe-l’œil, peut-être d’un trompe-cœur. L’image n’est pas simple mimesis pour Aristote mais phantasia. L’ombre projetée au mur n’est pas celle de la caverne de Platon, elle ne nous induit pas en erreur. Elle vient enrichir la mémoire, exercer ce bloc de cire, Mnémosyne, et notre propre capacité de projection, d’émotion, de compréhension.
En 1926, surplombant l’entrée de la salle de lecture de la Bibliothèque des Sciences de la Culture d’Aby Warburg, la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, le nom de Mnémosyne invoque un nouveau rapport aux images. Ce nom, Aby Warburg l’utilise aussi pour incarner son tout dernier projet, L’Atlas Mnémosyne.
En 1926, Aby Warburg n’a plus que trois ans à vivre. Il ne verra pas sa bibliothèque s’installer à Londres pour fuir l’Allemagne nazie, où elle forme aujourd’hui le cœur du Warburg Institute. Il ne pourra pas non plus finir son Atlas, sa toile de maître et toile d’internaute d’un autre temps. La bibliothèque devenue centre de recherche avait pour ambition dès l’origine d’augmenter les connaissances en histoire de l’art sans se soucier des frontières entre les sciences humaines et notamment l’anthropologie. Cette vision englobante faisait de la bibliothèque un espace fluide, mouvant, permettant comme le souhaitait Warburg « d’examiner ensemble l’image et la pensée qui s’y rattache » [lettre d’Aby Warburg à Otto Lauffer du 11 novembre 1925, publiée dans Erwin Panofsky, Korrespondenz 1910 bis 1936]. Il y a un désir de classification totale et, par ce moyen, d’orientation dans le monde. Deux axes aiguillent cette prise de position : « imagination identificatrice et raison distanciatrice ». L’image est supposément le seuil, cette dimension intermédiaire entre nous et le réel, lieu privilégié de la création artistique et interface favorisée de notre situation dans le monde.
Aussi l’Atlas Mnémosyne se veut une analyse de l’orientation de l’homme dans cet espace, l’espace de sa pensée, à travers l’histoire. Pour Warburg, toute direction a nécessairement un point d’origine, celui d’une mémoire, collective et individuelle, à partir duquel se développent les expressions artistiques, soit dans la convergence soit à contre-courant. Il propose ainsi, dans cette œuvre inachevée, près de quatre-vingt panneaux aux thématiques plus ou moins obscures censées explorer, par la confrontation des modèles anciens et modernes, associations d’idées et études comparatives, une compréhension de l’être au monde. Ces panneaux, analysés, décortiqués, restent parfois impénétrables, comme ces tableaux à clé, trompe-l’œil dont nous avons perdu le code il y a bien longtemps. Ils retracent des moments de l’histoire de l’art, et recroisent des permanences thématiques, selon les études psychologiques de l’empathie ou de la mémoire sociale. Ce travail iconologique est une étape majeure de la redistribution des images comme langage de la mémoire, une enquête sur l’évolution de l’expression de « la vie en mouvement ».
L’étape suivante fut mon agenda de 5e.
Mebane, Caroline du Nord. Un samedi matin de janvier 2004. Une maison pavillonnaire est en proie aux flammes. Dave Roth, un voisin et photographe curieux capture l’incendie. Sa fille Zoe se tourne vers lui, les yeux sans doute plissés par le sommeil, le sourire en coin. Le point est fait sur elle, le feu se distingue en arrière-plan, inextinguible. La photo fut postée en ligne pour la première fois en 2007. Vous l’avez vue depuis, et vous en avez vu les détournements, ce délice de voir la ruine.
Un meme de perfection *Chef’s Kiss Emoji*.
Je ne sais pas si vous avez eu cette chance, alors que vous alliez faire les courses pour la rentrée scolaire, de découvrir ces agendas. Leur couverture était brune d’un papier recyclé, nue. J’ai dû avoir un temps de latence dans le rayon où l’on se bousculait, avant de comprendre ce que cela impliquait : sous la protection transparente qui sentait encore le plastique neuf je pourrais tout dire et tout exprimer.
Atelier découpage. Les magazines traînaient étripés sur le tapis du salon, les pochettes d’album chauffaient sous la photocopieuse. Toute fière à l’école, je plaçais en évidence ce journal intime fait pour être vu. J’espérais chaque jour capter l’attention d’une camarade qui reconnaîtrait Joy Division, Fullmetal Alchemist ou le Velvet Underground, en vain. On pourrait croire qu’il s’agissait d’un obscur rite de sélection par connivence. Sans doute qu’aussi vraies que pouvaient être mes intérêts, ils avaient été choisis spécifiquement selon ce que j’imaginais être les goûts attendus (supposition évidemment biaisée par ma propre hauteur). Cette customisation était aussi bien un appel qu’une carapace. La qualité esthétique de la couverture contrebalancerait ce pathétique besoin d’attention. À présent que je ne suis plus drapée dans ce snobisme adolescent (dit-elle à moitié convaincue), je reconnais que la question n’était pas que les autres connaissent ou non, mais s’intéressent ou non. Cette main tendue vers l’autre ne devait pas avoir l’air de grand chose, tout au plus d’un regard désespéré depuis le fond de la classe.
S’afficher comme ça, aussi entière et confiante, contrastait avec la discrétion évidente qui a dû régner dans ma chambre. Je ne me permettais que quelques timides photos et cartes postales au-dessus de mon bureau (au centre duquel, pour être tout à fait transparente, il m’avait pris un jour de graver le nom de mon crush). Cet espace n’était pas un refuge, et j’allais bientôt le partager avec mon frère. Il fallait laisser ma sœur grandir, avoir son propre espace. Combien de personnes trans ont dû grandir du mauvais côté de la fratrie, s’étouffer sous la couette ? Je ne rendais visible qu’une maigre culture commune, mangas et DVDs, comme branche d’olivier fraternelle, dans une chambre qui ne reflétait que du noir.
Est-ce là qu’internet me sauve ?
Internet se cache au-delà de ces papiers découpés. Et pendant des années j’y resterai engluée. Pendant des années, même après avoir quitté le foyer, c’est dans la chambre de ma sœur que je venais respirer, où je trouvais un réconfort, une normalité absente des murs nus de mon adolescence : ma couverture d’agenda retrouvée constellée en tête de lit, le miroir maquillé au feutre, les guirlandes lumineuses, la pile de CDs en désordre contre la chaîne stéréo. Aussi caricatural que ça puisse paraître, cette esthétique, cette culture, me font regretter encore aujourd’hui d’avoir été si peu présente sur internet jusqu’à la fin des années 2000. J’aurais peut-être compris qui j’étais sur un forum des fans de Antony & The Johnsons, musique que nous écoutions en boucle avec ma mère lorsque nous repeignions la chambre, seul souvenir heureux de cette période : la chambre était alors réellement nue.
La chambre que je n’ai jamais osé avoir, c’est aussi le skyblog ou myspace que je n’ai jamais osé tenir, mon chat MSN Messenger jamais activé. C’est une chambre cyborg en négatif, une chambre aux « identités fracturées », pour reprendre le Manifeste de Donna Haraway, déconnectée de tout réseau mais paraissant au monde ni comme moi ni comme une autre, incomplète et pourtant vécue. Elle aurait pu être, ma chambre. Comme moi d’ailleurs : cette fracture positive aurait alors pu être celle d’un prisme révélateur total, d’un espace sans restriction, poursuivie en ligne dans une exploration de soi et des réseaux sociaux. J’aurais pu me placer dans le monde, lire et lier l’autre et moi-même.
Je connais finalement peu de paroles de chansons. Et si je n’ai jamais connu celles de We Didn’t Start the Fire de Billy Joel, je n’ai eu aucun problème à mémoriser celles de la parodie produite par CollegeHumor en 2009, We Didn’t Start The Flame War. La vidéo est un condensé des comportements agressifs, propos violents et memes épuisants typiques de l’internet de l’époque. 10ans plus tard, les sections de commentaires ont-elles vraiment changé ? On a seulement appris à ne pas aller voir.
Aby Warburg voulait rendre au monde une cartographie élémentaire des mouvements de l’âme humaine à travers la retranscription des archétypes qui structurent nos images. Notre seule différence (peut-être que tout snobisme ne m’a pas totalement quitté), lorsque nous mettons à nu un similaire tableau, est que nous tentons d’exprimer une histoire intime, à notre échelle individuelle. Mais nous espérons, nous savons, que cette mise en images trouvera ailleurs un reflet similaire. Là où l’historien trace les connexions existantes entre deux images, nous nous accrochons instinctivement à l’une en espérant provoquer la réponse d’une autre intimité, détentrice d’une autre image qui ne sera jamais exactement la même.
Cette exactitude impossible de l’image répétée me fascine. Je parle là de ce que l’image contient de potentiel. J’imagine dans cette dimension intermédiaire l’autonomie de l’image : cet « acte d’image » dont Horst Bredekamp tente de démêler les implications. L’acte est interaction : on ne fait pas ce que l’on veut de l’image car elle n’est pas ce que l’on veut. Elle EST véritablement (et Platon reconnaissait ce paradoxe), elle n’est simplement pas ce qu’elle prétend être. C’est ce jeu de va-et-vient qui fait de l’image une « influence visible sur la sensation, la pensée et l’action ». Une camarade, voyant la jaquette de Joy Division miniature qui orne mon agenda, comprendra immédiatement mon intérêt pour le groupe, y verra peut-être un pont entre nous deux. Elle y retrouvera aussi ses propres impressions, sa première écoute, différente de la mienne, un déferlement involontaire de tout ce qui est là fois contenu en elle et en l’image. S’arrêter à la référence culturelle est pauvre, en émotion comme en engagement, simple réseau de surface. C’était peut-être suffisant à l’époque. Ce qui m’importe aujourd’hui c’est cet espace d’engagement, entre l’image et soi, entre l’image et l’autre. Le hasard des images rythme notre lecture du monde. Internet accélère ce rythme, multiplie les rencontres fortuites, mais n’a pas vocation à le rompre, ni rester en surface.
Aussi reproduite que soit l’image, on peut espérer qu’elle ne sera jamais vue pareil. Sur internet les images sont dédoublées, copiées : des sites miroirs appauvrissent leur qualité, mais jamais notre capacité à réagir.
Déjà à l’aube de l’image imprimée, les usages et appropriations étaient aussi nombreuses qu’il y avait d’exemplaires. Ainsi peuvent en témoigner des manuscrits d’Augsbourg. Au sein du monastère de la ville, les moines possédaient leur propre presse. Aussi, chaque moine possédait son propre ouvrage de dévotion, quatorze sont conservés, qui tous conservent entre leurs pages la même gravure du Christ en croix. Mais celle-ci, au-delà de son rôle dévotionnel évident, venait s’inscrire avec une certaine liberté dans le livre, et chaque religieux l’ornait et la personnalisait, coupant le crâne au pied de la croix, encrant de rouge le corps de Jésus, baignant d’or la page qui l’accueillait, commentant surtout l’image de psaumes et phrases latines rituelles. Pour Peter Parshall, ce travail d’individualisation et d’appropriation est essentiel dans la création d’une « image mémoire ».
Cette image mémoire, je ne la conçois pas seulement comme support extérieur, disque dur : l’image est certes déclencheur d’un processus mémoriel, mais elle vient elle aussi s’inscrire dans notre propre récit imagier, nœud le long d’un fil enchevêtré qui constitue notre mémoire.
C’est pour ça entre autres, que j’adore Tabloid Art History. Le projet, lancé sur le ton de la blague en novembre 2016 sur Twitter par deux étudiantes en histoire de l’art Elise Bell, Chloe Esslemont, rejointes par Mayanne Soret, a tiré sa révérence au mois de mai. Pendant plus de deux ans, elles ont proposé d’augmenter notre vision de la culture visuelle contemporaine en proposant des parallèles avec des œuvres d’art et une réflexion critique honnête sur le monde de l’art. Leur zine invita des créations artistiques variées, et des articles sur les pratiques et productions contemporaines, selfie ou nail art, mal vues alors qu’elles ont tant à dire. Leur marque de fabrique était la confrontation d’images qu’aucun lien objectif ne semble réunir. L’inclusion de la Pop Culture qui est généralement considéré comme low-brow, photographies de célébrités par des paparazzi, émissions de télé-réalité, aux côtés de celle high-brow des galeries et musées a pour effet de dynamiter nos perceptions aussi bien de l’histoire de l’art que nos jugements de valeur sur la société de consommation contemporaine.
Lorsque Tyra Banks, jury d’America’s next Top Model en 2007, demande aux participantes ‘Hoe, but make it fashion’ en pressant ses seins et se penchant vers l’avant, la caméra ni elle n’ont vraisemblablement à l’esprit une Marie-Madeleine dont les mains prêtes à se joindre en prière cachent de manière similaire sa poitrine. Mais TAH l’a vu. Et nous le voyons à présent. Et ce parallèle iconique une fois soulevé est incontestable et indélébile. Il marque l’histoire de l’image et la nôtre.
La pratique évidemment ne date pas d’elles. La recherche d’un pattern, d’un motif commun est inhérente à tout moment de l’histoire humaine, et pratiquement chaque instant de nos vies. C’est ce qui nous fait voir des constellations dans le ciel, des profils humains dans notre papier peint. Mais il y avait dans l’union sincère et réfléchie proposée par TAH des enjeux spécifiques. L’image d’aujourd’hui n’est finalement pas si différente de celle d’hier. Certains schémas n’ont jamais changé ou si peu, et nos grilles de lecture doivent être assez souples pour permettre de comprendre la spécificité de chacune au sein du flot constant qui nous emporte. Je suis très attachée à la sincérité du procédé, aussi simple et superficielle que puisse être une mise en parallèle à sa conception. C’est grâce à cela que l’on se laisse embarquer par l’image pour en apprendre plus, y voir plus clair, la replacer dans un moment, et se l’approprier. Il y a un caractère profondément ludique à mettre en image une intuition, un déjà-vu, incorporer une nouvelle image dans notre historique intime et social.
Le meme twitter bientôt mort du « [insérez une célébrité] as [insérez ici un objet sans rapport] » marque pour moi dans certains cas un détournement brillant de cette fascination pour les parallèles mais bien plus souvent une regrettable perte de sens au nom de la création de contenu. Il y a un manque de recul, qui nie à l’image sa dimension propre, intermédiaire, celle où on peut s’y glisser pour y voir autre chose. Car justement, il n’y a plus qu’une chose : le parallèle devient un cadre contraignant, l’image redevient un mur où rien n’est projeté d’autre que ce que l’on veut nous faire voir. En somme, c’est un média à valeur marchande, celle de la tendance, où la diffusion est fin en soi.
Le cartooniste KC Green publia en janvier 2013 un webcomic intitulé The Pills Are Working. Vous le connaissez, peut-être pas dans son intégralité. Un chien assis à sa table boit tranquillement son café, tandis que la pièce brûle. ‘This is fine’ commente le chien.
Les cases se suivent, il continue de nier la réalité. Il tente de se convaincre que tout va bien se passer, reprenant une gorgée alors même qu’il prend feu. Mais on ne retiendra sans doute que les deux premières vignettes, celles à valeur choc. Tout y est ou presque, notre incapacité à réagir, notre confort dans l’ignorance, la violence que l’on s’inflige pour ne pas abandonner ce que l’on est, ce que l’on connaît. L’icône brûle comme dans la pire timeline, et on l’agite vainement, on la reposte par réflexe face à l’absurde.
À l’époque où Aby Warburg entreprend son Atlas, une autre lecture du monde et de l’intelligence collective tentait d’émerger en Europe. L’objectif est ailleurs cette fois. Il ne s’agit pas de lier le passé au présent selon les modèles de la pensée exprimés dans l’art, mais de cumuler selon un ordre strict et précis tout le savoir du monde, pour espérer réunir en un seul nœud l’humanité.
C’est un projet pacifiste et universaliste que le Mundaneum, dont le nom même sonne comme une nouvelle de science-fiction. Ouvert en 1920 à Bruxelles au Palais du Cinquantenaire, le Mundaneum avait pour ambition de réunir la somme des connaissances du monde. À son origine se trouve un homme, Paul Otlet, « L’homme qui voulait classer le monde » comme le surnomme Françoise Levie. Avec son ami Henri La Fontaine, frère de l’activiste féministe Léonie La Fontaine qui créa l’Office central de documentation féminine, il ouvre en 1895 l’Institut International de Bibliographie. Cet institut annonce un objectif plus vaste, beaucoup plus vaste, un répertoire bibliographique universel. Les œuvres de tout temps et de tout lieu y seraient cataloguées.
Pour classifier cette somme exhaustive du savoir mondial, le système de classification Dewey, celui toujours en place dans nos bibliothèques, ne suffit pas. Il est trop restreint malgré sa précision : la Classification Décimale Universelle que propose Otlet est un véritable langage chiffré, et la logique se veut d’une objectivité absolue. L’ensemble est standardisé, du format de la fiche où sont notées les informations de l’objet au mobilier qui les accueillera. Tous ces ouvrages indexés deviennent partie d’un seul livre, celui de la Science Universelle. Le désir de Paul Otlet ne s’arrête pas aux ouvrages écrits cependant, et il crée pour ce livre d’images un Répertoire iconographique universel. Et pour faciliter le partage des livres, il invente le microfilm, celui-là même qu’on peut encore consulter pour ne pas abîmer les documents rares sur ces machines de bibliothèques, faisant défiler les pages au bruit d’une cassette qu’on rembobine. Sa vision était en avance sur le monde, sa technologie aussi. Après plusieurs échecs et déménagements, les restes de ce travail monumental sont désormais visibles au centre d’archives bruxellois à Mons.
Paul Otlet est souvent présenté comme le précurseur d’internet. Il ne doit pas cette réputation qu’à ce travail sur la CDU. Dans son Traité de documentation de 1934, il parle d’une « immense machinerie pour le travail intellectuel. Elle se constitue par la combinaison des différentes machines existantes, dont les liaisons nécessaires s'entrevoient. Cette machinerie constituerait un véritable cerveau mécanique et collectif. » Est-ce ce à quoi ressemble internet aujourd’hui ?
On pourrait croire qu’il parle de google, dont l’ambition d’un catalogage total se retrouve via google books ou artsandculture. Plus en phase avec son esprit d’ouverture et d’accessibilité aux données, j’ai envie d’y voir les projets portés par Wikimedia. Wikipédia évidemment avec quoi tout a commencé. Mais aussi Wikimedia Commons, base iconographique libre de droit. Plus récemment Wikidata est venu bouleverser l’ensemble : cette base entend réaliser pour chaque entité de l’univers, chaque concept de notre pensée, une fiche unique, avec son identifiant. Il en existe aujourd’hui plus de 5 milliards. Les fiches sont structurées de telle manière que chaque élément descriptif de celle-ci soit une autre entité fichée. Cette inter-connectivité est clé : les métadonnées ainsi structurées permettent à la machine de lire et naviguer entre les entités. Un tel réseau, si dense, pourrait-il structurer de la même manière le fil hasardeux de mon rapport au monde, c’est-à-dire des images qui m’ont parlé et de mes impressions ?
Je ne sais pas si vous regardez des contenus sur Amazon Prime. Une des fonctionnalités me fascine et m’effraie tout particulièrement, X Ray. Lorsque vous regardez un programme, ce scanner a la capacité, scène par scène, d’indiquer la musique qui est jouée, les acteurs qui apparaissent grâce à IMDB. De la part d’Amazon, on peut craindre qu’ils nous proposerons automatiquement sur leur site mère les livres de la bibliothèque d’un personnage, les vêtements qu’il portait. Sur l’image téléguidée s’écrasent nos fantasmes.
Face à une dystopie capitaliste totalitaire, de quoi puis-je rêver ?
Where were you when la flèche de Notre-Dame est tombée ?
Soyons honnêtes deux minutes et reconnaissons la qualité magique de voir un monument en proie aux flammes. Entendre les cloches funèbres sonner. Les jours qui suivirent, matin et soir, je prenais le temps de m’approcher. Mais je tournais vite le dos à la cathédrale pour observer la foule. À la recherche de l’image unique, celle d’une absence, d’une erreur dans la représentation du réel dont on n’arrive pas immédiatement à identifier l’origine. Les photographies de l’incendie resteront. J’en ai vu plusieurs, sur le subreddit /r/AccidentalRenaissance consacré aux photographies élégamment structurées, capturant parfaitement l’instant dramatique. Le feu a un sens indéniable de la composition.
Il y a souvent, lorsque l’on parle d’internet mais aussi plus largement de la culture mondiale aujourd’hui une inquiétude profonde, la peur d’être enseveli. Cette inquiétude fut celle après le développement de l’impression, de la lithographie, du livre de poche. L’expression consacrée veut que nous soyons assaillis d’un déluge d’images. Notre quotidien est rythmé par la publicité, l’information en boucle, le selfie, la storification des vies.
Cette inquiétude est toutefois paradoxale. On souligne d’une part la crainte d’une perte de réalité, d’une désensibilisation. C’est le raisonnement que je me permets lorsque moi-même je reste en surface imperturbable à des images perturbantes, en prétextant que 4chan m’y a habituée. D’autre part, on insiste en permanence sur la valeur choc de certains contenus et leur impact potentiel, particulièrement sur les jeunes esprits. On pourrait voir ces deux facettes comme complémentaires, mais où se trouve alors l’image de trop, le basculement ? Bredekamp a raison de rappeler, à la suite d’Ernst Gombrich, que « la surproduction des images ne supprime pas leur force et ne la neutralise pas ». Et je reste convaincue que ce que nous apprend l’image n’est pas uniquement la réalité qu’elle présente mais aussi le comportement social que l’on doit avoir face à elle. Aucun recul n’est permis, nous sommes contraints jusque dans notre réaction.
La publicité comme l’information continue sont centrales à cet enjeu. Le concept marxiste de fétichisation de la marchandise a évolué en fétichisation de l’image. L’idée de fétiche dénude l’image de tout ce qui la rend unique et la contextualise, elle la prive de ses rapports privilégiés et de sa capacité d’expression propre pour en faire un mur à slogan #OBEY.
John Berger critiquait vivement la publicité, cœur battant du système et de la culture capitaliste. La publicité est cynique. La publicité impose une restriction du désir, ou plutôt des libertés de désirer. La publicité par les images mêmes qu’elle offre à voir en masse étouffe notre capacité à voir ailleurs, à voir ces images dans un tissu autre que le voile sous lequel le capitalisme couvre notre perception.
Internet subit ce flux constant. L’immédiateté de l’information capte tant l’attention qu’on ne recule que difficilement pour prendre le temps, choisir de voir. La publicité omniprésente disperse le regard, et biaise le choix de consommer. Chaque image tient en elle une capacité à nous renvoyer à notre rapport d’être au monde. C’est toujours le manque de recul. Ma grande crainte est qu’on ne laisse plus s’exprimer l’image, justement en épuisant son sens. L’image redeviendrait support, et on ne la verrait plus. On lirait seulement, à travers elle, un discours qui n’est pas sien.
Je rêve de connexion. Pas celle proposée par une entreprise qui envisage le monopole du web. Je rêve du hasard, d’une cartographie du hasard.
Il y a une fascination insatiable pour le feu. Et rien ne prend feu comme internet.
Je pense souvent à cette collection d’images que serait ma mémoire comme à un cocon. Ce cocon m’effraie parfois, comme s’il était un morceau de ce voile, petit bout de confort capitaliste dans lequel je m’enroulerais. Les images vues et revues m’engourdissent et je sombre dans cette torpeur qui me voit visiter le monde sans rien voir réellement.
Ailleurs, je me dis que cette collection s’étend indéfiniment grâce aux dimensions numériques qui nous sont ouvertes. Interviewée dans Href Zine, l’artiste Samantha Harvey cite Yuval Noah Harari, qui parle de notre évolution en ‘Homo Deus’, une humanité capable de s’augmenter par la technologie. Augmenter sa mémoire, sa capacité de lecture et de raisonnement. Une bibliothèque totale digne de Borges, un palais de la mémoire à rendre jaloux Sherlock seraient alors à ma portée, capables d’accueillir une infinité d’images, selon la classification que je leur souhaiterais. La peur qui me prend cette fois est toute différente, celle de l’immensité (oui j’ai eu les Pensées de Pascal au bac). J’ai longtemps cru qu’il serait possible de tout lier, sémantiquement. Je voulais tracer le fil rouge entre toute choses, et décrire comme une structure organique un rapport au monde dont le rythme est fondamentalement imprédictible.
Le tableau du Déjeuner sur l’Herbe de Manet est un écho au Concert Pastoral de Raphaël, avant d’être lui-même cité dans de nombreuses œuvres lui rendant hommage ou le parodiant. Mais c’est aussi le tableau devant lequel Blair Waldorf en vacances à Paris rencontre Louis Grimaldi. Et je me souviens de cette époque où nous regardions Gossip Girl en streaming sur Megavideo avec ma petite sœur. Voilà un fil de ma vie, qui ressurgit et s’enrichit chaque fois que je revois le musée d’Orsay, Leighton Meester ou qu’il est question de streaming (en 2019??). Je suis Charlie de It’s Always Sunny in Philadelphia les yeux écarquillés devant son crazy board. Toute image est indice.
Dans la préface de son ouvrage intitulé Le Détail – pour une histoire rapprochée de la peinture, Daniel Arasse annonce l’échec de toute entreprise exhaustive sur le sujet : « Un seul exemple suffit pour, d’emblée, se convaincre des innombrables chemins entrecroisés que le détail ouvre à une analyse de type historique ». Que dire donc d’une analyse intime, où chaque image laisse entrevoir une descente semblable à Alice dans le terrier, la même Alice qui se plaignait de lire un livre sans images ?
Références :
Arasse Daniel, Le Détail – Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, 1992
Areford David S., The Viewer and the Printed Image in Late Medieval Europe, Ashgate, 2010
Benjamin Walter, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, 1955
Bredekamp Horst, Théorie de l’acte d’image, Éditions la découverte, 2015
Caliandro Stefania, Images d’images – Le métavisuel dans l’art visuel, L’Harmattan, 2008
Eco Umberto, De Bibliotheca, L’Échoppe, 1986
Href Zine, Issue 1, 2018, URL : <https://href-zine.net/printed-version.html>
Levie Françoise, L’homme qui voulait classer le monde – Paul Otlet et le Mundaneum, Les Impressions Nouvelles, 2006
Pon Lisa, A printed icon in early modern Italy : Forlì's Madonna of the Fire, Cambridge University Press, 2015
Stoichita Victor, L’instauration du tableau : Métapeinture à l’aube des temps modernes, Librairie Droz, 1999
TabloidArtHistory, TAH Vol.1, 2018, URL :
<https://tabloidarthistorycom.files.wordpress.com/2019/01/tahvol.1.pdf>
TabloidArtHistory, TAH Vol.2, 2019, URL :
<https://tabloidarthistorycom.files.wordpress.com/2019/02/tahvol2-web-pages.pdf>
Walskaar Thomas, Save and Forget, Rotterdam, 2016-2017, accessible en ligne : <https://www.walskaar.com/images/Save_and_Forget.pdf>
Warburg Aby, L’Atlas Mnémosyne, l’Écarquillé, 2012
- Titre
- Historique des images
- Date
- 8 mai 2019
- Langue
- Français
- Description
- Version longue du texte publié dans WWDS #1
- Collections
- Dans les tiroirs
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
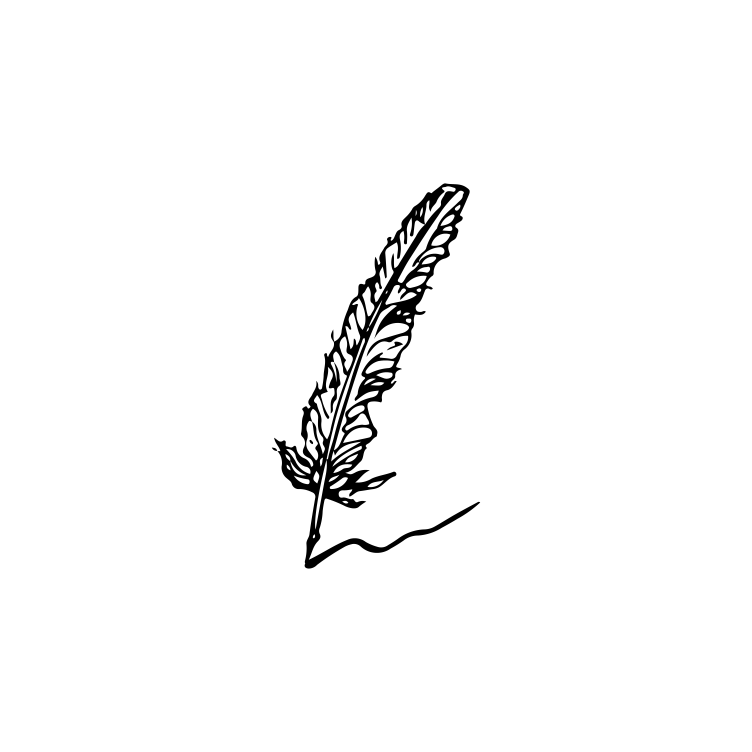 Historique des images Historique des images |
Texte |
Commentaires
Pas encore de commentaire ! Soyez le premier à en ajouter un !