« le passage d’une image à une autre permet de sentir que, sans secret ni centre, c’est par le transport d’une chose qui fait battre le cœur à une autre, d’un souvenir à l’autre, que sans cesse et sans fin de la mémoire se construit comme un réseau. »
Raymond Bellour, Qu’est-ce qu’une madeleine, p.83
Surplombant l’entrée de la salle de lecture, Μνημοσύνη veille.
Déesse de la mémoire dans la mythologie grecque, Mnémosyne est aussi mère des Muses. Le don de la mémoire est paradoxal, d’autant plus lorsqu’il est mis face à la noblesse des arts sous la protection des Muses : à sa racine, la mémoire est ce qui nous permet de nommer, de catégoriser à partir de notre expérience du monde ; aussi les Muses président à des arts liés aux discours, fondés sur cette capacité que nous avons à construire et raisonner à partir de ces catégories.
Mais la représentation visuelle, si essentielle à la pensée selon Aristote, ne figure pas au rang des arts. C’est qu’elle fonctionne dans un entre-deux hors de nos plans de réalité langagiers. Il y a une immédiateté de l’image qui nous bouleverse hors de nos constructions intellectuelles, nous interpelle sur le réel.
En 1926, surplombant l’entrée de la Bibliothèque des Sciences de la Culture d’Aby Warburg, le nom de Mnémosyne invoque un nouveau rapport aux images. Car c’est ce même nom que l’historien de l’art appose à son ultime projet, l’Atlas Mnémosyne.
Son intérêt pour la création humaine dépasse la discipline stricte de l’histoire de l’art : il entend fusionner de manière organique les sciences humaines. Pour cela sa bibliothèque est conçue comme un espace fluide permettant « d’examiner ensemble l’image et la pensée qui s’y rattache ». À sa suite, l’Atlas veut proposer une cartographie de la pensée humaine. À sa mort en 1929, il avait dressé 90 panneaux, réunissant œuvres et coupures de presse, selon des thématiques iconographiques, études psychologiques de l’empathie ou de la mémoire sociale.
Ce travail iconologique est une étape majeure de la redistribution des images comme langage de la mémoire, une enquête sur l’évolution de l’expression de « la vie en mouvement ».
L’étape suivante fut mon agenda de 5e.
Je ne sais pas si vous avez eu cette chance, alors que vous alliez faire les courses pour la rentrée scolaire, de découvrir ces agendas. Leur couverture était brune d’un papier recyclé, nue. J’ai dû avoir un temps de latence dans le rayon où l’on se bousculait, avant de comprendre ce que cela impliquait : sous la protection transparente qui sentait encore le plastique neuf je pourrais tout exprimer.
Atelier découpage. Les magazines traînaient étripés sur le tapis du salon, les pochettes d’album chauffaient sous la photocopieuse. Toute fière au collège, je plaçais en évidence ce journal intime fait pour être vu, mood board définitoire. J’espérais chaque jour capter l’attention d’une camarade. On pourrait croire qu’il s’agissait d’un obscur rite de sélection par connivence. Cette customisation était aussi bien un appel qu’une carapace. La qualité esthétique de la couverture contrebalancerait ce pathétique besoin d’attention.
Cette main tendue vers l’autre ne devait pas avoir l’air de grand chose, tout au plus d’un regard désespéré depuis le fond de la classe. Mais s’afficher comme ça, aussi entière et confiante qu’il était possible sur un ridicule bout de papier, contrastait avec la discrétion évidente qui a dû régner dans ma chambre. Cet espace n’était pas un refuge, et j’allais bientôt le partager avec mon frère. Il fallait laisser ma sœur grandir, avoir une chambre à elle. Combien de personnes trans ont dû grandir du mauvais côté de la fratrie, s’étouffer sous la couette ? Je ne rendais visible qu’un écho des intérêts familiaux dans une pièce qui ne reflétait de moi que du noir.
Est-ce là qu’internet me sauve ?
Internet se cache au-delà de ces papiers découpés où, pendant des années, je resterai engluée. Pendant des années, même après avoir fui la colocation familiale, c’est dans la chambre de ma sœur que je venais respirer, où je trouvais un réconfort, une normalité absente des murs nus de mon adolescence : ma couverture d’agenda retrouvée constellée en tête de lit, le miroir maquillé au feutre, les guirlandes lumineuses, la pile de CDs en désordre contre la chaîne stéréo. Aussi caricaturale qu’elles puissent paraître, cette esthétique, cette culture, me font regretter encore aujourd’hui d’avoir été si peu présente sur internet jusqu’à la fin des années 2000.
La chambre que je n’ai jamais osé avoir, c’est aussi le skyblog ou myspace que je n’ai jamais osé tenir, le chat MSN Messenger jamais activé. C’est une chambre cyborg en négatif, une chambre aux « identités fracturées », pour reprendre le Manifeste de Donna Haraway, déconnectée de tout réseau mais paraissant au monde ni comme moi ni comme une autre, incomplète et pourtant vécue. Elle aurait pu être, ma chambre. Comme moi d’ailleurs : cette fracture alors positive aurait pu être celle d’un prisme révélateur total, d’un espace sans restriction, poursuivi en ligne dans une exploration de soi et des réseaux sociaux. J’aurais pu me placer dans le monde, lire et lier l’autre et moi-même.
P.-A. Michaud parle à propos de l’Atlas d’une « iconologie des intervalles ». Le hasard, jamais si fortuit, des rencontres d’images provoque une lecture toujours différente et jamais interrompue.
C’est ce que je cherche, lorsque je me livre en images, à travers des papiers découpés ou fichiers numériques : je n’attends pas seulement la reconnaissance, mais aussi l’extension des savoirs et des émotions. Des milliers d’images sont déroulées comme un film insensé sous nos yeux chaque jour. Mais le plus profond désir humain, celui d’unir les étoiles en constellation, trouver un motif dans l’absurde, nous fait saisir les bobines, remplir les intervalles.
Tabloid Art History, projet de jeunes historiennes de l’art sur les réseaux, faisait ainsi entrer en résonnance œuvres d’art et culture populaire : un nœud était épinglé, de deux images, deux moments. C’est de façon plus large la structure fondamentale d’une grande partie de la culture du mème, la juxtaposition de deux éléments, réunis par l’absurde et le fil ténu d’un motif qui nous parle.
De l’Atlas à TAH, en passant par mon agenda de 5e, un même élan nous anime : l’image ne vit jamais seule.
Si l’internet de demain est celui des données liées, je rêve d’un autre type de connexion, celle de nos subjectivités. Car les images ne sont pas un langage, ou plutôt, elles appellent une telle diversité de lectures, au creux d’un instant, qu’elles ne peuvent être réduites à une donnée. Chaque image peut éventuellement s’épanouir en un microcosme de nos sentiments, une capsule pour notre mémoire. Warburg envisageait d’interroger les images au sein d’un moment de l’humanité, de tisser les liens, établir des constantes, à travers les époques et les civilisations. Internet aujourd’hui fait basculer cette toile à l’échelle des individus. A travers les collections d’images que nous accumulons, celles que nous diffusons, nous établissons une cartographie de nos intimités.
Internet est un monde de données et d’échanges. Mais c’est à la lumière des images, au-delà des rives du langage, que nous naviguons vers le hasard, que nous abordons la réalité de l’autre.
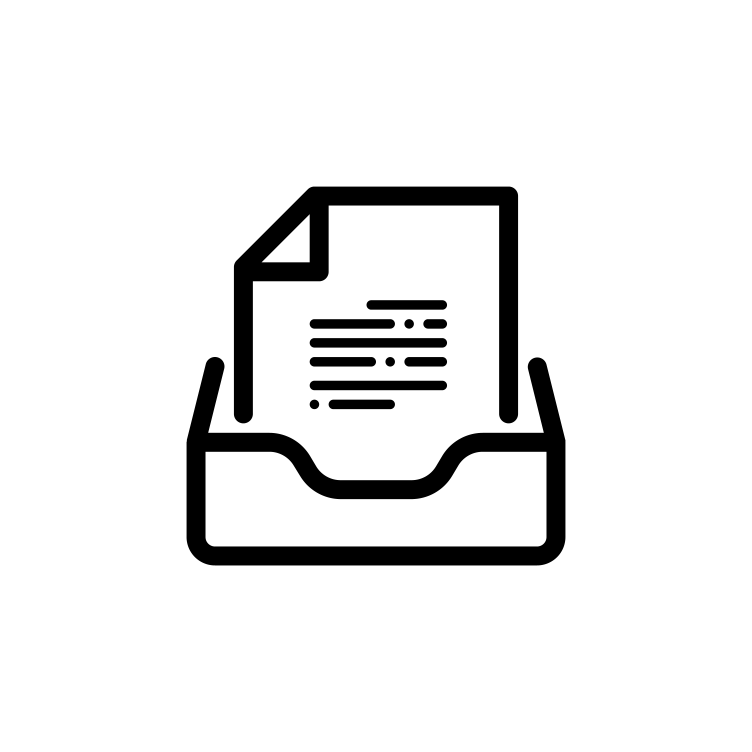 Historique des images
Historique des images
Commentaires
Pas encore de commentaire ! Soyez le premier à en ajouter un !